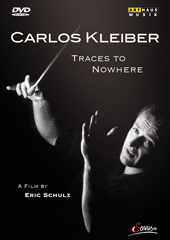Eva-Marie
Westbroek (Anna Nicole)
Susan
Bickley (Virgie)
Jeremy
White (Daddy Hogan)
Rebecca
de Pont Davies (Aunt Kay)
Loré
Lixenberg (Shelley)
Alan
Oke (J. Howard Marshall II)
Mark-Anthony
Turnage, musique
Richard
Thomas, livret
Richard
jones, mise en scène
Nicky
Gillibrand, costumes
Miriam
Buether, décors
Royal
Opera Chorus
Orchestra
of the Royal Opera House
Antonio
Pappano, direction
Opus
Arte OA BD 7088D
Anna
Nicole Smith était une Aphrodite de pacotille, impératrice pendant
quelques années du plus mauvais goût typiquement mercantiliste et
profondément américain, bien que le reste du monde occidental a
malheureusement finit par suivre la vague. Issue d’un minable
patelin texan, elle amorça sa « remarquable » carrière
dans un bar tout aussi sordide, blonde platine et « boostée »
sans plus d’avenir que n’importe quelle de ses congénères, si
ce n’est, comme elles, d’avoir la possibilité d’être un jour
« découverte » par un magazine (ou un producteur de
films) érotique, voir pornographique.
Et c’est
ce qui arriva! En 1992, elle fit son entrée dans le Playboy (dans le
genre, tout de même, c’est la grande classe). Le reste ne fut
qu’une longue série de frasques bouffonnes et grotesques virant
parfois sur l’ordurier.
Quelques-unes
de ses fredaines pathétiques devraient ici être énumérées, afin
de bien camper le personnage.
En 1994
elle épousa, à 26 ans, un milliardaire sénile et souffreteux de 89
ans, qui ne l’accabla pas plus longtemps de sa présence puisqu’il
eut la décence de mourir dans l’année suivante. Ses funérailles
furent inoubliables : la veuve éplorée s’y présenta en robe
de mariage passablement dégarnie, question de bien marquer les
esprits sur sa « disponibilité »…
Elle qui
s’était fort probablement marié pour l’argent du vieux
schnoque, s’est ironiquement battu tout le reste de sa (courte) vie
contre la famille du défunt pour obtenir sa part de l’héritage,
auquel elle ne toucha jamais. En effet, au moment de sa mort, la
cause traînait toujours dans les méandres judiciaires.
Ce
qu’elle manquait en talent (pour ainsi dire tout), elle le
compensait en vulgarité et en effronterie. Elle se présenta à un
gala artistique états-unien complètement ivre (bien au-delà de
toute interdiction de conduire. Il lui a probablement fallu deux
accompagnateurs pour la mener à la salle de bain et l’empêcher de
s’y noyer). C’est tout juste si elle n’écarta pas les jambes
« on national TV »
afin d’inviter le premier venu à profiter de sa « générosité ».
Elle
accoucha d’une fille par césarienne devant les caméras, dans une
sorte de télé-réalité dégoûtante et dépassant toutes les
limites de l’opportunisme mal avisé.
Après
ce monument de créativité télévisuelle, elle épousa son avocat
et lors de leur voyage de noces sur un yacht près des Bahamas, elle
fit encore parler d’elle en commandant d’urgence un repas de
qualité pour fêter ce moment magique : un dîner Poulet Frit
Kentucky, envoyé directement du continent états-unien svp!
Serez-vous
surpris si je vous dis qu’elle est décédée à 39 ans (en 2007),
bourrée de médicaments?
Maintenant,
la question qui tue : mais que diable la direction du Royal
Opera House est allée faire dans cette galère en commandant un
opéra sur ce sujet?
Il faut
voir bien au-delà du sujet proprement dit pour apprécier l’audace
de la proposition. Anna Nicole Smith était une icône de truculence
et de mauvais goût. Mais elle est (en fait, elle est devenue) une
métaphore de tout un aspect complètement déjanté de la
culture-spectacle populiste, véritable cyclone qui emporte des pans
entiers de la société, malheureusement, mais indéniablement.
Ce
besoin d’être « vedette » et célèbre, peu importe la
nature de ce qui attirera les projecteurs, est bien présent chez des
millions de gens. Une masse affamée, exsangue à force d’être
intellectuellement vidée et siphonnée par la médiocrité et
l’omniprésence du divertissement industriel, regardais Anna Nicole
en s’en moquant, certes, mais en se disant qu’elle aussi pourrait
être « vue » et « connue », en étant moins
débile bien entendu. Le pire, c’est qu’il est probablement
impossible pour tous ces gens accrochés à un certain star-système
voyeuriste et superficiel de réellement éviter les pièges béants
de la grotesquerie, celle-ci imbibant entièrement tout l’esprit de
cette sous-culture navrante.
Autrement
dit, si Anna Nicole vous donne envie d’être célèbre vous aussi,
ladite célébrité, si elle survient, vous transformera
inévitablement en… Anna Nicole. Mais bref, le point de cette
critique n’est pas l’analyse sociologique d’un épiphénomène,
mais plutôt l’appréciation d’un opéra contemporain.
Et de
cet opéra, qu’en est-il? Je le dirai tout de suite, c’est une
intéressante réussite. Les créateurs (Mark-Anthony Turnage,
brillant compositeur britannique actuel, l’audacieux librettiste
Richard Thomas et le metteur en scène Richard Jones) ont illuminé
la vie scabreuse d’une playmate désespérée de touches d’humanité
et d’un brin tendresse, mais sans jamais camoufler le caractère
avilissant et tristement burlesque de ses extravagances. Aucune
complaisance, donc, mais une tentative, réussie, de ramener Anna
Nicole Smith à son niveau de femme, certes pathétiquement
inadaptée, mais humaine et victime autant que complice d’un
système plus vaste qui écrase et abrutit des populations entières.
Mark-Anthony
Turnage signe une partition éminemment théâtrale, profondément
appropriée, teintée de jazz, de pop et de soul dans un canevas
orchestral ample et riche, et issue d’une lignée évidente qui
nous ramène inévitablement à Bernstein et Weill, mais avec une
dose raisonnable et non-abusive de modernité contemporaine.
Le
livret de Richard Thomas ne s’éloigne pas trop d’un
« terre-à-terre » correspondant au niveau de langage des
personnages, des Américains manifestement peu lettrés. Mais il sait
rendre à cette « ordinaireté » langagière son rythme
urgent et direct, et lui fournir une couche supplémentaire de sens
et de symbolisme. Quelques écarts plus poétiques occasionnels et
savoureux, appuyés par une trame symphonique somptueuse, élèvent
presque Anna Nicole au rand de personnage puccinien.
La mise
en scène, colorée, active et prolifère finit de créer un opéra
contemporain qui fera date. On prouve ici avec conviction que l’opéra
n’a pas besoin de se référer uniquement à de grands thèmes
antiques, à des concepts symbolistes alambiqués ou aux classiques
de la littérature « sérieuse » pour pouvoir se donner
un nouveau souffle et s’épanouir au 21e
siècle. Au contraire, le monde contemporain, même dans ses
turpitudes les plus frivoles, peu servir cet art total. Et celui-ci,
à son tour peut servir le monde en illuminant de façon intelligente
ses pires excès.
Frédéric
Cardin
 Concerto pour clarinette en A major K622 (Mozart).
Concerto pour clarinette en A major K622 (Mozart).